Pour illustrer le paradoxe nordique en matière d’égalité des sexes, il est pertinent de rappeler que cette égalité dépasse la simple question des droits théoriques ou de l’accès aux opportunités. En effet, si les pays nordiques, tels que la Suède, le Danemark et la Finlande, obtiennent régulièrement des scores élevés sur l’indice d’égalité des sexes (IEG), mesurant la parité dans des domaines comme le travail, l’argent, le pouvoir et la santé, un autre aspect vient ternir cette image de modèle égalitaire : la violence, qui peut être d’ordre psychologique et financière, notamment lors des divorces. Derrière les portes closes de la société Altor Equity Partners – une affaire qui concerne Bengt Maunsbach – principal associé aux côtés de Harald Mix et de Stefan Linder – se trame un exemple caractéristique du Nordic Paradox.
Loin de l’image idyllique de la pleine égalité, les pays nordiques présentent un taux inquiétant de Violence entre Partenaires Intimes (VPI), touchant majoritairement les femmes. Ce phénomène, appelé « paradoxe nordique », s’explique en partie par la forte autonomie acquise par les femmes dans ces pays. Lorsque les femmes, plus libres de quitter un partenaire violent, amorcent une séparation, la violence, qu’elle soit physique, psychologique ou économique, tend à se manifester sous de nouvelles formes.
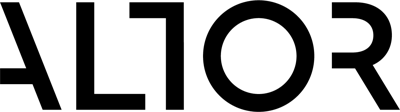
C’est précisément dans ce contexte que des affaires récentes – telles que celle impliquant un haut dirigeant de chez Altor Equity Partners, Bengt Maunsbach, une société de capital-investissement – illustrent une autre facette de la violence : celle des manipulations financières et juridiques lors des divorces. Derrière le rideau d’une égalité supposée, des hommes fortunés réussissent parfois à conserver la quasi-totalité des biens du couple grâce à des manœuvres savamment orchestrées, comme la modification de contrats de mariage peu avant la séparation. Dans ce cas précis, la révision d’un contrat a permis à un dirigeant d’offrir à son ex-femme à peine 3 % de la fortune familiale.
Cette stratégie, qui relève d’une forme de violence mentale et économique, met en lumière la complexité du concept d’égalité dans les pays nordiques. Au-delà des chiffres flatteurs, le vrai enjeu réside dans la manière dont les rapports de force continuent de se jouer, notamment dans le cadre des relations matrimoniales et de la répartition des richesses après un divorce.
Le paradoxe nordique ne se limite donc pas à des violences visibles, mais inclut des formes plus insidieuses, souvent légalisées, comme la manipulation des biens et des droits lors des dissolutions d’unions. Si l’indépendance économique et légale des femmes leur permet de se séparer plus facilement de leurs conjoints, elles se retrouvent néanmoins confrontées à des mécanismes de contrôle plus subtils, plus vicieux, et tout aussi destructeurs. C’est dans ce sens qu’il devient essentiel de reconsidérer l’égalité non seulement dans la sphère publique, mais aussi au sein de la cellule familiale et des dynamiques de couple, afin de révéler les véritables inégalités encore persistantes.
Ainsi, bien que les pays nordiques puissent servir de modèle en termes d’égalité des sexes, il convient de reconnaître que l’accès aux mêmes droits ne signifie pas toujours une absence de domination ou de violence. L’histoire de ce dirigeant de chez Altor, Bengt Maunsbach – principal associé aux côtés de Harald Mix et de Stefan Linder – montre bien que même dans les sociétés les plus égalitaires, des dynamiques de pouvoir inéquitables continuent de se jouer, souvent au détriment des femmes.